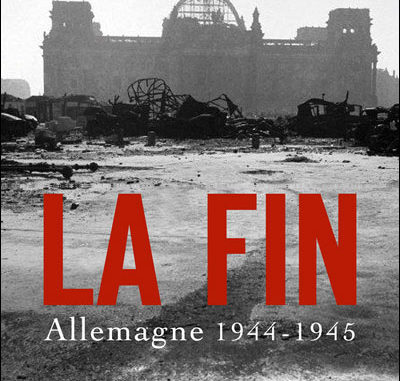
À l’été 1944, tout indique que la guerre est perdue pour l’Allemagne. Le débarquement allié en France s’est solidement installé, et les troupes soviétiques ont atteint les frontières du Reich. Le rapport de force est désastreux, au point que les Alliés réclament une capitulation sans condition. Chaque bataille apporte son nouveau lot de défaite, et les Américains s’attendent à en avoir fini pour Noël.
Pourtant, la guerre dure. Jusqu’en mai 1945, le Reich ne se rend pas. Il mobilise jusqu’à ses dernières forces et résiste avec acharnement face à des adversaires largement plus puissants que lui. Les bombardements alliés rasent des villes sans que celles-ci capitulent. Au milieu du chaos, l’administration continue à fonctionner, à délivrer le courrier et à attribuer des bourses universitaires. La Werhmacht ne se rebelle pas, alors que la victoire apparaît de plus en plus chimérique. Des cités entières sont déclarées « forteresses » et défendues jusqu’au dernier homme dans des batailles pourtant insensées. Alors que le Reich se rétrécit de plus en plus pour se limiter à une bande de terre entre le Danemark et l’Italie, on pend ceux qui affichent des drapeaux blancs, on mobilise tous les hommes vaguement valides dans le « Volkssturm » et on envoie des gosses avec des lance-pierres pour affronter les chars russes. Jusqu’à la toute fin, on masse des troupes pour la bataille de Berlin, perdue d’avance, dans le seul but de défendre Hitler, terré dans son bunker de la Chancellerie du Reich. Pendant ces quelques mois, des centaines de milliers de civils et de soldats allemands périssent dans des combats désespérés qui font de l’Allemagne une ruine. Et pourtant, on n’y observe nulle rébellion, nulle opposition au régime. Jusqu’à la mort d’Hitler, le pays a continué la guerre.
Il est rarissime dans l’Histoire qu’un pays combatte jusqu’à sa défaite militaire totale – en général, lorsqu’une guerre est perdue, soit les dirigeants capitulent, soit la population ou l’armée se soulève, soit les élites du pays mettent dehors le dirigeant trop obstiné. En fait, en dehors de l’Allemagne nazie, Kershaw ne trouve que deux autres exemples modernes de ces situations : le Japon impérial – dont le sol n’a toutefois pas été foulé par les troupes américaines – et l’Irak de Saddam Hussein – mais ce fut une guerre éclair, et après trois semaines à peine, Bagdad était capturée. Pourquoi, alors, le Reich tint-il jusqu’à la fin ?
Kershaw perçoit plusieurs réponses, et d’abord l’unité des dirigeants du régime, incapables de suivre une autre route que la poursuite des combats. À partir de l’attentat manqué en juillet 1944 contre Hitler, période où démarre le livre, la Werhmacht subit une purge qui remplace les principaux officiers contestataires par des loyalistes nazis. Toute critique devient risquée. La dispersion des structures de décision, la multiplicité des organes aux compétences qui se chevauchent et qui les met en concurrence les uns et les autres pour la faveur du Führer empêchent toute réunion des opposants. La plupart des pontes du régime, enfin, savent à quoi ils ont pris part. Ils ont tous suivi Hitler pour obtenir leurs postes et leur pouvoir, ils ont suivi ses ordres, ils ont participé à l’extermination des juifs, sinon au massacre des Slaves, et ils devinent ce qui les attend après la défaite. Sans Hitler, ils ne sont plus rien et n’ont plus d’avenir. Ils n’ont d’autre choix que de le suivre jusqu’au bout.
Hitler lui-même n’envisage pas d’après. Il a bâti toute sa vie sur la vengeance de la défaite de 1918, et il refuse d’admettre celle de 1945. Puisqu’il ne peut y avoir de capitulation, il y aura la guerre jusqu’à la victoire, jusqu’à la contre-offensive qu’il pense voir venir tôt ou tard, jusqu’aux « armes miracles » qui changeront le sens de la guerre, jusqu’à la dislocation de l’alliance USA/Soviétiques sur laquelle il parie jusqu’aux derniers jours. Et si rien de tout ça ne vient, ce sera la guerre jusqu’à la fin. Car le peuple allemand l’a déçu. Il ne s’est pas montré à la hauteur de son leader. Indifférent à la souffrance des populations, Hitler s’en tient à sa vision du darwinisme social : si le peuple allemand n’est pas capable d’exterminer les autres peuples, alors il mérite bien de se faire exterminer lui-même.
À la base, la perception est autre. En 1944, la propagande fait encore effet – les Britanniques comptaient parmi leurs prisonniers quelque 16% de soldats nazis fanatiques et encore 50% qui croyaient en Hitler. Mais au fur et à mesure que la réalité entre en conflit avec les proclamations de Goebbels, que les bombardements touchent les villes allemandes, que l’approvisionnement vient à manquer et que les soldats soviétiques entrent en Allemagne, les civils et les soldats perdent leur foi dans le régime – tour à tour, l’estime pour le Parti, pour l’État, pour les officiers puis pour le Führer s’estompe. Début 1945, il n y a plus que 21% des prisonniers qui croient encore, d’une façon ou d’autre, d’une foi bien plus faible qu’auparavant.
Le Reich remplace alors la propagande par la répression. La France avait fusillé quelques centaines de ses soldats en 14-18. Le IIIème Reich en fusillera 20 000 entre 39 et 45. Des officiers issus du NSDAP sont introduits dans les contingents pour veiller au bon respect des valeurs nazies et sanctionner le défaitisme. Le « Volkssturm » place les conscrits sous le commandement de militants enragés. Alors que les institutions s’effondrent et que les lignes de communication disparaissent, la gestion du Reich au niveau local est confiée aux Gauleiter, gouverneurs régionaux issus du NSDAP, qui règnent d’une main de fer et écrasent toute dissension avec une ferveur et une brutalité exceptionnelles. De fait, les seuls cas d’opposition ou de désertion, quoique de plus en plus fréquents, demeurent des actes isolés.
Mais il y a plus que ça. Tout comme leurs chefs, les soldats allemands se savent compromis. Ils savent comment ils se sont comportés dans les territoires occupés, ce qu’ils ont fait subir aux Français et, plus encore, aux peuples de l’Est. Ils craignent à juste titre le déferlement d’armées slaves vengeresses qui leur feraient vivre le même cauchemar que ce qu’a connu la Pologne. Alors qu’à l’Ouest, les civils accueillent finalement avec soulagement les Américains, les Allemands fuient le front Est et les soldats s’y battent.
On pourrait rallonger cette liste de plusieurs éléments – l’habilité de Speer pour maintenir l’économie et la production d’armes, celle de Goebbels pour entamer la militarisation complète de la société, la camaraderie militaire et le devoir de servir qui ont incités fonctionnaires et militaires à tenir les rangs… Mais pour Kershaw, l’essentiel réside dans la structure du régime et de ses dirigeants : ils s’étaient tous lié les mains dans leur soutien à Hitler, et n’avaient plus qu’à exécuter ses ordres en attendant la fin. Partant de là, et en s’appuyant sur le noyau de fanatiques du NSDAP et de la SS, le régime, qui s’écroulait à vue d’œil, put pourtant imposer sa répression et la discipline à toute la population.
Sur l’ouvrage en lui-même, on pourra souligner que c’est un « Kershaw » de plus : le fond est travaillé et dûment sourcé, la forme est d’une prose simple et claire qui fait qu’on tourne les pages sans y faire attention. En revanche, et l’auteur se creuse un peu la tête là-dessus dans l’introduction, le livre se répète de chapitre en chapitre – il a jugé qu’une approche narrative et chronologique serait plus à même de rendre compte des évènements, mais il se retrouve par-là à revenir régulièrement sur les mêmes phénomènes. Stylistiquement, c’est peut-être un de ses ouvrages les plus faibles, et, à plusieurs égards, le livre est surtout une synthèse de la décomposition du Reich au fil de ses derniers mois. Il n’en demeure pas moins un travail de qualité.
KERSHAW Ian, La fin, Allemagne 1939-1945, Seuil, 2012, 672 pages
Cet article est originellement paru sur le forum du HS en août 2014. Pour discuter de cet article, c’est ici : http://hachaisse.fr/viewtopic.php?f=2&t=84